- INTERSEXUALITÉ
- INTERSEXUALITÉL’intersexualité peut se définir par la présence, chez un même individu appartenant à une espèce gonochorique (à sexes séparés), de caractères sexuels intermédiaires entre le mâle et la femelle. Par opposition à l’hermaphrodisme qui est au sens précis du terme une forme de reproduction sexuée, l’intersexualité est le résultat d’une anomalie de la différenciation sexuelle. Les intersexués sont souvent désignés sous le terme plus vague d’hermaphrodites accidentels. On ne peut classer parmi les intersexués les individus qui présentent seulement des modifications des caractères sexuels secondaires traduisant une inversion apparente du sexe (exemple: la castration chez l’adulte suivie de greffes de gonades ou d’injections d’hormones sexuelles). Il existe dans le règne animal une grande variété d’intersexués spontanés chez lesquels des modifications profondes se sont exercées à un stade précoce du développement embryonnaire. De nombreux cas ont été décrits chez les Mammifères (porc, vache, chèvre) et chez l’Homme. Ces sujets présentent soit des glandes génitales mixtes ayant en même temps la structure d’un ovaire et d’un testicule, soit des glandes génitales unisexuées et des conduits génitaux mixtes. On explique actuellement la genèse de ces anomalies à la lumière des expériences d’intersexualité qui ont été pratiquées dans toutes les classes des Vertébrés et qui ont été étendues à plusieurs espèces d’Invertébrés.D’après les études récentes sur la formule chromosomique et sur la fusion des œufs de Mammifères, on peut vraisemblablement interpréter comme des gynandromorphes bi-partis les êtres humains qui possèdent d’un côté un hémi-appareil génital mâle et de l’autre côté un hémi-appareil génital femelle. La compréhension des phénomènes d’intersexualité impose la connaissance du déroulement par étapes de la différenciation sexuelle.Différenciation sexuelleLe sexe d’un embryon se détermine au moment de la fécondation [cf. REPRODUCTION]. La détermination génétique du sexe dépend de la répartition des chromosomes sexuels X et Y dans l’œuf. Chez la plupart des animaux, la constitution génétique de l’œuf est homogamétique chez la femelle (XX), hétérogamétique chez le mâle (XY). Chez les Oiseaux et chez certains Amphibiens, la situation est inverse; la formule mâle est ZZ, la formule femelle ZW. Il existe une certaine relation entre la nature du sexe homogamétique et la capacité d’inversion sexuelle.La détermination génétique ne se manifeste pas dès le début du développement embryonnaire, elle est le point de départ d’une succession de phénomènes complexes qui vont réaliser la morphologie mâle et femelle d’un être vivant. La première étape qui suit la fécondation correspond à l’organogenèse des glandes et des conduits génitaux (caractères sexuels primaires). Dans chaque embryon, quel que soit son sexe génétique, s’édifie un double assortiment d’ébauches qui comporte les éléments nécessaires à la réalisation d’un système génital mâle et d’un système génital femelle (cf. HERMAPHRODISME, fig. 2). Cette phase de développement semblable est appelée phase d’indifférence ou de bipotentialité sexuelle . Lui succède la phase de différenciation sexuelle au cours de laquelle on assiste au développement de l’un des deux systèmes et à l’atrophie de l’autre. Les organes génitaux externes qui prolongent les voies génitales sont eux aussi bipotentiels au moment où apparaissent leurs ébauches. Les facteurs qui déterminent le développement ou la régression de l’un des deux systèmes génitaux sont les hormones sexuelles comme l’ont mis en évidence les expériences d’intersexualité.La nature chimique de ces facteurs: œstrogènes et testotérone, ainsi que les voies de leur synthèse par les gonades embryonnaires sont à l’heure actuelle clairement établies (L. Cedard, A. Guichard, K. Haffen, D. Scheib, J. P. Weniger). Les cellules responsables de ces sécrétions appelées cellules «interstitielles» ont été bien identifiées. Dans le cas particulier du testicule fœtal de Mammifère exite (A. Jost, 1953) une hormone capable de provoquer la régression des canaux de Müller, d’où sa dénomination d’hormone «anti-müllérienne». Sa nature protéique a permis sa purification à l’aide d’un anticorps monoclonal (N. Josso et al., 1981).Intersexualité hormonaleVertébrésLes recherches sur l’intersexualité hormonale des Vertébrés ont eu pour point de départ l’étude chez les Bovidés, d’intersexués spontanés dits free-martins : lorsqu’une vache porte des jumeaux de sexes différents, dont certaines annexes embryonnaires (chorions) présentent des anastomoses vasculaires, le mâle est normal, la femelle est intersexuée. Le plus faible degré d’intersexualité correspond à la transformation des gonades en ovotestis. Les intersexués «forts» sont caractérisés par une masculinisation presque complète des gonades, par la régression des conduits femelles et le développement des conduits mâles (fig. 1). Ces observations ont conduit simultanénment, en 1916, l’Américain Frank Lillie et les Autrichiens Karl Keller et Julius Tandler à penser que des substances hormonales élaborées par l’embryon mâle masculinisent l’embryon femelle. Pour vérifier cette hypothèse et reproduire artificiellement les free-martins , on entreprit une expérimentation comportant d’une part les parabioses d’embryons, les greffes de gonades, d’autre part les injections d’hormones sexuelles.– Parabioses embryonnaires et greffes de gonades . Les parabioses embryonnaires ont été effectuées chez les Amphibiens par R. K. Burns et par E. Witschi à partir de 1992. Elles ont consisté à souder flanc contre flanc deux jeunes embryons de Batracien. Dans le cas où les deux têtards sont de sexe différent, le têtard femelle est masculinisé par le têtard mâle: le cortex ovarien régresse, la médullaire se transforme en testicule. Parfois, c’est le partenaire mâle qui est féminisé.Des résultats décisifs ont été obtenus en greffant directement une gonade dans un organisme larvaire. La greffe d’un testicule différencié dans une larve femelle d’Ambystoma mexicanum (R. R. Humphrey, 1929) ou de Pleurodeles waltlii (L. Gallien, 1954) a abouti à des changements de sexe tels que les individus génétiquement femelles transformés en mâles ont pu être croisés avec de vraies femelles et fournir une descendance dont l’étude a démontré (1945) l’hétérogamétie (ZW) du sexe femelle de ces espèces. En effet, si la femelle avait été homogamétique, le croisement entre deux femelles n’aurait donné que des femelles. Or on obtient 25 p. 100 de mâles et 75 p. 100 de femelles (fig. 2). Toutefois, l’hypothèse de l’hétérogamétie femelle entraîne comme conséquence l’existence de deux catégories de femelles: normales (WZ) et anormales (WW). Effectivement, certaines femelles (WZ) de la génération 1 croisées avec des mâles (ZZ) engendrent autant de mâles que de femelles. En revanche, si les femelles (WW) sont croisées avec des mâles (ZZ), elles donnent naissance uniquement à des femelles, ce qui vérifie l’hypothèse (fig. 2).– Injections d’hormones sexuelles . Chez les Oiseaux, les injections d’hormones sexuelles ont été réalisées pour la première fois en 1935 par trois groupes de chercheurs (V. Dantchakoff en Lituanie, B. H. Willier et coll., aux États-Unis, E. Wolff et A. Ginglinger en France). L’injection d’hormones femelles (folliculine, œstradiol) aux embryons de poulets mâles au début de l’incubation produit suivant la dose et le stade de l’intervention différents degrés d’intersexualité allant jusqu’à l’inversion complète des gonades et des voies génitales. Mais alors que les transformations produites sur le tractus génital sont définitives, la féminisation des gonades ne se maintient pas au-delà de l’éclosion; le poussin féminisé se transforme après quelques mois en un coq fonctionnel qui possède testicules et voies génitales mâles, tout en conservant l’oviducte apparu au cours de la vie embryonnaire. Une explication partielle de ce phénomène a été donnée par l’étude du comportement des cellules germinales mâles, amenées par voie expérimentale à évoluer dans une gonade femelle (K. Haffen). L’injection d’hormones mâles , telle la testostérone, aux embryons femelles masculinise seulement le tractus génital car chez les Oiseaux, le sexe femelle est dominant. Cette action est tout à fait parallèle à celle de l’hormone naturelle contenue dans les testicules embryonnaires. L’effet des hormones sécrétées par les gonades embryonnaires a été mis en évidence par les expériences de greffes et de parabioses en culture in vitro (E. Wolff et coll.).Chez les Amphibiens (L. Gallien, E. Witschi et coll.) et chez les Poissons (T. Yamamoto), des résultats très remarquables ont été obtenus avec des hormones sexuelles. Dans plusieurs cas, des inversions complètes et définitives ont abouti à des croisements féconds.Chez les Mammifères, les expériences classiques de greffes, de parabioses ou d’injections d’hormones sexuelles n’ont jamais permis de réaliser la transformation des gonades. Les Mammifères aplacentaires constituent cependant une exception, puisque l’injection d’hormones femelles à de jeunes marsupiaux (opossum) déclenche la transformation des gonades mâles en ovotestis constitués d’un noyau testiculaire et d’un cortex ovarien. Chez tous les autres Mammifères (rat, lapin, souris), seule la féminisation ou la masculinisation du tractus génital a été réalisée par des injections d’œstrogènes ou d’androgènes. C’est Alfred Jost qui a expliqué ces échecs, en démontrant, en 1947, par la méthode de castration chirurgicale pratiquée sur des fœtus de lapin in utero, que, sans gonades, les jeunes animaux se développaient comme des femelles, quel que soit leur sexe génétique. De plus, l’administration de testostérone au fœtus mâle castré ne peut inhiber les canaux de Müller, ce qui suggérait l’intervention d’une hormone fœtale, présente chez le fœtus mâle non castré, qui fut appelée hormone antimullérienne.InvertébrésOn a longtemps ignoré l’existence d’hormones sexuelles chez les Invertébrés. H. Charniaux-Cotton a découvert chez les Crustacés une glande androgène (fig. 3). Des expériences de greffes ont montré que cette glande est capable de transformer une femelle en mâle. Inversement, chez un mâle privé de sa glande androgène, la différenciation mâle des caractères sexuels s’arrête, et l’ovogenèse s’installe dans les testicules. De même chez les insectes, l’autodifférenciation femelle et l’existence d’une hormone androgène responsable de la différenciation mâle des caractères primaires ont été démontrées par Y. Naisse chez le ver luisant.Intersexualité provoquée par la températureLes premières expériences ayant montré qu’une température différente de la température normale d’élevage provoquait chez les Amphibiens anoures l’inversion du phénotype sexuel sont dues à E. Witchi (1914, 1929). Cependant, aucune preuve génétique de cette inversion n’avait été apportée avant les travaux de C. Houillon et C. Dournon (1978) sur un Amphibien urodèle: Pleurodeles waltlii Michah . Ces auteurs ont pu montrer que les larves femelles de cette espèce, élevées à 30 0C, étaient transformées, soit en intersexués, soit en mâles phénotypiques. Le croisement de ces néo-mâles ZW avec des femelles standard ZW a fourni une descendance conforme aux prévisions théoriques, à savoir 1/4 de mâles phénotypiques (ZZ) et 3/4 de femelles phénotypiques (ZW, ZW, WW) apportant ainsi la preuve irréfutable de l’inversion complète du phénotype sexuel sous l’influence de la température.La possibilité d’inversion du phénotype sexuel sous l’influence de la température a également été démontrée chez de nombreux Reptiles. Les travaux dans ce domaine ont porté sur des aspects génétiques, évolutifs et écologiques. Jusqu’à présent, seules les recherches de C. Pieau effectuées chez les Tortues, depuis 1971, visent à élucider le mécanisme d’action de la température au niveau de la synthèse des stéroïdes sexuels.Intersexualité génétiqueL’intersexualité génétique, due à la constitution génétique même des sujets qui la manifestent, s’observe chez des animaux à faible détermination sexuelle. Chez ces animaux, l’un des groupes de gènes masculinisants (M) et féminisants (F), qui sont portés à la fois par les hétérochromosomes et par les autosomes, n’assure pas la dominance qui oriente dans le sens mâle ou femelle le développement sexuel de l’embryon.L’intersexualité génétique chez les Invertébrés peut être consécutive à certains croisements, par exemple entre races «fortes» et races «faibles» du papillon Lymantria dispar. Des anomalies génétiques telles la polyploïdie, l’aneuploïdie et certaines mutations provoquent l’intersexualité chez la drosophile. Ainsi, le croisement des drosophiles diploïdes normales avec des drosophiles triploïdes donne une descendance composite: à côté des femelles et des mâles de type normal, d’autres individus présentent des anomalies de leurs caractères sexuels; certains sont stériles, et leur morphologie est intermédiaire entre celle des deux sexes, ce sont les intersexués.L’intersexualité génétique est bien connue dans l’espèce humaine. Elle peut résulter d’une déficience du gène qui code pour le récepteur de la testostérone, empêchant ainsi la masculinisation de sujets génétiquement mâles et dotés de testicules dans un corps d’aspect féminin [cf. HORMONES], d’anomalies de la différenciation sexuelle consécutives à une formule chromosomique aberrante; les troubles hormonaux qu’elles manifestent ont pour origine une anomalie chromosomique. Les sujets atteints du syndrome de Klinefelter présentent une formule du type XXY: ils sont d’aspect masculin, mais au moment de la puberté leurs glandes mammaires ont un développement de type féminin; leurs glandes génitales, de structure testiculaire, restent infantiles. Chez les sujets atteints du syndrome de Turner , la formule chromosomique est de type XO: ils sont d’aspect féminin, mais leurs gonades sont absentes ou atrophiées; le tractus génital est de type femelle immature. Ces deux exemples représentent des dysgénésies gonadiques (cf. Anomalies sexuelles , chap. 6 d’appareil GÉNITAL).Ils posent le problème du déterminisme génétique de la différenciation testiculaire. E. Witschi (1931) avait postulé l’existence d’une induction chimique agissant au niveau de l’ébauche gonadique. À la suite des travaux de S. Wachtel et S. Ohno (1975), on devait, pendant une dizaine d’années, confondre la substance active avec une protéine, HY, qui jouait un rôle dans les phénomènes d’histocompatibilité (rejet par la souris femelle d’une greffe de peau de souris mâle). On sait, depuis 1985, que c’est non pas sur le bras long du chromosome Y (où le gène HY se trouve) mais à l’extrémité de son bras court (région pseudoautosomique) que se trouve le gène masculinisant. D’abrod appelé TDF (testis determining factor ), ce gène a reçu ensuite le sigle SRY (sex region Y ). Son rôle a été prouvé par des expériences de masculinisation de souris par transgenèse et par l’analyse de mutations humaines féminisantes par suite d’anomalies dans la séquence des nucléotides de SRY (M. Fellous et al.). Par conséquent, ce gène code bien pour un facteur protéique responsable de la masculinisation. Cependant, il n’est pas exclu que d’autres gènes de masculinisation existent, en particulier sur les autosomes, c’est-à-dire les chromosomes «non sexuels»: on les désigne par TDA ou TDX et ils sont l’objet d’études actives.
intersexualité [ ɛ̃tɛrsɛksɥalite ] n. f.• 1931; de inter- et sexualité1 ♦ Biol. Caractère d'un individu qui change de sexe au cours de son évolution.2 ♦ Génét. État d'un individu qui présente un mélange de caractères sexuels mâles et femelles.♢ Spécialt (génét. humaine) ⇒ hermaphrodisme, transsexualisme.
● intersexualité nom féminin Évolution individuelle des animaux d'espèce gonochorique, dont tout ou partie des caractères sexuels s'inversent au cours de la vie. (Chez les crépidules [mollusques] les individus sont d'abord mâles, puis femelles. Les femelles d'anguille se masculinisent avant l'état adulte en général.) État d'un individu chez lequel coexistent des caractères sexuels mâles et femelles. (Dans l'espèce humaine, il s'agit de l'hermaphrodisme et du pseudo-hermaphrodisme.)⇒INTERSEXUALITÉ, subst. fém.BIOL. Caractère d'un individu qui achève son développement avec le sexe opposé à son sexe génétique ou qui présente simultanément des attributs masculins et féminins. Les intersexualités (ou hermaphrodismes) d'origine génétique, et les intersexualités d'origine pathologique, dues par exemple à une tumeur des glandes surrénales ou sexuelles (CUÉNOT, J. ROSTAND, Introd. génét., 1936, p. 110). Il [Goldschmidt] obtint tous les degrés d'intersexualité avec structure hermaphrodite des gonades jusqu'à inversion complète du sexe génotypique en le sexe opposé (Hist. gén. sc., t. 3, vol. 2, 1964, p. 679).Rem. Certains aut. l'emploient uniquement dans un sens restrictif. L'intersexualité suppose une succession, l'hermaphrodisme une simultanéité d'états respectivement mâles ou femelles (Biol., 1965, p. 1226 [Encyclop. de la Pléiade]).Prononc. : [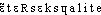 ]. Étymol. et Hist. 1931 (GARNIER et DELAMARE, Dict. des termes techn. de méd. ds QUEM. DDL t. 20). Composé de inter- et de sexualité. Bbg. QUEM. DDL t. 20.intersexualité [ɛ̃tɛʀsɛksɥalite] n. f.❖1 Sexualité présentant des caractères ambivalents, mais à prédominance mâle ou femelle. ⇒ Hermaphrodisme. || Intersexualité « femelle » évoluant vers le sexe mâle (gynandroïde). || Intersexualité « mâle » évoluant vers le sexe femelle (⇒ Androgyne). || Intersexualité normale, chez certaines espèces (insectes, batraciens). ⇒ Intersexué (phase intersexuée). || Intersexualité complète. ⇒ Bisexualité.2 Pathol. État d'un individu intersexué.
]. Étymol. et Hist. 1931 (GARNIER et DELAMARE, Dict. des termes techn. de méd. ds QUEM. DDL t. 20). Composé de inter- et de sexualité. Bbg. QUEM. DDL t. 20.intersexualité [ɛ̃tɛʀsɛksɥalite] n. f.❖1 Sexualité présentant des caractères ambivalents, mais à prédominance mâle ou femelle. ⇒ Hermaphrodisme. || Intersexualité « femelle » évoluant vers le sexe mâle (gynandroïde). || Intersexualité « mâle » évoluant vers le sexe femelle (⇒ Androgyne). || Intersexualité normale, chez certaines espèces (insectes, batraciens). ⇒ Intersexué (phase intersexuée). || Intersexualité complète. ⇒ Bisexualité.2 Pathol. État d'un individu intersexué.
Encyclopédie Universelle. 2012.
